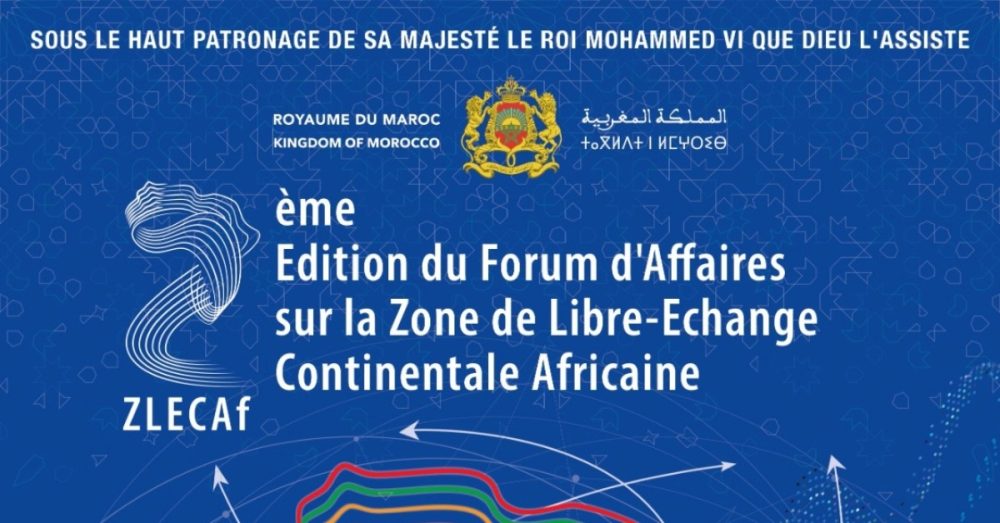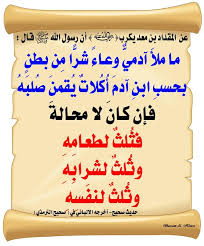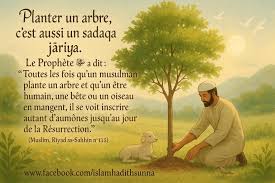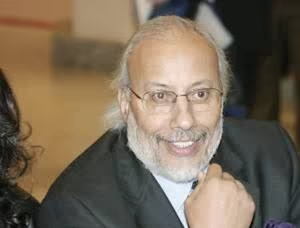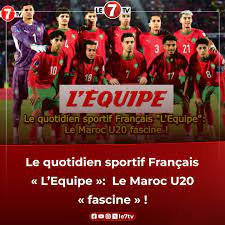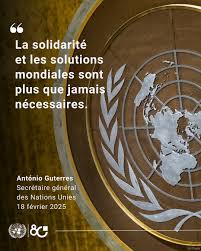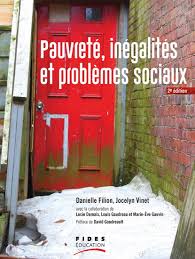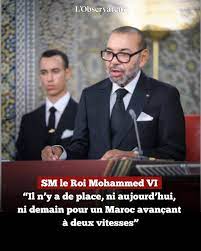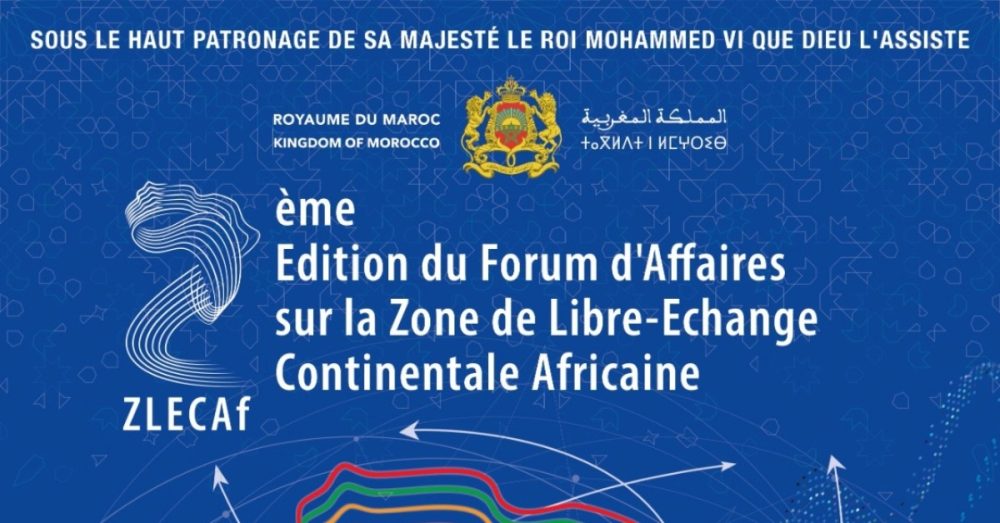
Du 11-12 Décembre 2025, la 2éme édition du Business Forum de la Zone de libre-échange continentale africaine ZLECAF s’est tenue à Marrakech avec grande ambition de switcher du stade de l’accord juridique à celui du projet économique transformateur pour l’ensemble de l’Afrique.
Rétrospectivement, après Addis-Abeba en 1963, Abuja en 1991 et Durban en 2002, Kigali marqua une étape charnière de l’intégration commerciale sur le contient noir qui ambitionne que 90 % des échanges de biens seront dégrevés des droits de douane, et abolit de facto les 84.000 kilomètres de frontières entre les pays du continent Africain.
Sur l’échiquier économique mondial et étonnamment à la mondialisation heureuse qui promit monts et merveilles de la libéralisation du commerce mondial, et au regard de la formation de blocs commerciaux en Amérique latine, en Europe, en Asie, ce n’est plus un choix pour les pays Africains, mais un must de constituer un bloc commercial régional dense et intégré et résilient à même de renforcer la compétitivité de l’Afrique, surtout dans un environnement mondial marqué par une incertitude accrue, le nationalisme industriel et la fragmentation. De telles réalités économiques nous interpellent que notre continent doit compter sur son marché intérieur pour assurer son autosuffisance économique, à compter sur sa capacité productive et approfondir les chaînes d’approvisionnement intra-africaines
Le Souverain Marocain n’a-t-il pas allégué, dans un éloge majestueux en date du Mardi 31 Janvier 2017 adressé au 28ème sommet de l’Union Africaine que la création de la zone de libre-échange, la plus large au monde, représente un acte majeur de notre volonté commune de construire l’Afrique de demain en soulignant que les richesses de l’Afrique doivent profiter à l’Afrique.
À notre sens, cet aggloméré commercial, en l’occurrence la ZLECAF, ne pourra réussir sans les prérequis suivants :
▪ Primo, une plus grande insertion de l’économie africaine dans la trajectoire de la géopolitique internationale : l’Afrique reste la zone la moins intégrée au monde. Sa part dans le commerce mondial demeure modique puisqu’elle ne représente que 3% du commerce mondial.
A titre d’exemple, nonobstant une nette progression (30 Milliards de dirhams), les exportations Marocaines vers l’Afrique ne représentent que 7% du commerce extérieur du Royaume. Un hiatus qui, reflète la dissonance entre l’adhésion juridique à la ZLECAF et la réalité économique. Difficile avec un tel ratio de percer les marchés mondiaux en pleine compétition et de négocier en force les accords internationaux. Ce qui illustre la nécessité d’accélérer la mise en œuvre opérationnelle de la ZLECAF.

▪ Secundo, le déploiement d’un grand effort d’intégration et de synergie du commerce intra-régional : au vu des chiffres timides du Commerce international entre les pays Africains livrés par l’OMC et ONU commerce et développement, il est urgent de remédier à la faible connectivité entre les différentes économies du continent. Faut-il illustrer la timide jonction commerciale entre les pays Africains : le commerce intra-africain ne dépasse guère 14,4 % en 2024, comparativement à l’Asie (ASEAN) et les pays d’Asie de l’Est qui ont dépassé 1,73 trillion d’USD en 2023, soit 49,7% de la valeur totale des échanges de l’ASEAN ou en Europe où il s’élève à 300 Milliards d’euro en 2024.
Cette proportion, très en deçà des standards Asiatiques ou Européens démontre la fragmentation des marchés africains et la dépendance structurelle du continent aux partenaires extérieurs. En outre, de telles statistiques montrent, de par leur éloquence, l’effort que doivent prodiguer les pays Africains dans le cadre de la ZLECAF pour augmenter le commerce intra-africain à plus de 35 Milliards de dollars par an pour gravir les 52% en 10 ans. Aussi, le commerce intra-africain est entravé par les embuches telles que les réseaux de transport, les processus douaniers et frontaliers et l’accès au financement.
En sus, La Banque Mondiale note dans plusieurs rapports que les économies Africaines dépourvues d’accès maritime supportent des coûts commerciaux jusqu’à 50% plus élevés que celles disposant d’une façade océanique. Ces surcoûts logistiques, qui affectent autant les importations alimentaires et énergétiques que les exportations agricoles ou minières, se répercutent directement sur les niveaux d’inflation et la compétitivité des économies enclavées.
▪ Tertio, l’alliance et la forte implication du secteur privé : la réussite de la ZLECAF reste fortement tributaire de sa capacité à riposter aux besoins de l’entreprise. À cet égard, il est capital que le secteur privé fournisse des mécanismes de consolidation des chaînes de valeurs existantes par la promotion de l’investissement industriel et le transfert du savoir-faire. Sous cet angle, les PME, qui constituent 80 % des entreprises Africaines, seront encouragées par la ZLECAF, où elles pourraient fournir des inputs pour les grandes entreprises industrielles.
A cet égard, Casablanca Finance City, plateforme financière de premier plan sur le continent, la présence de groupes bancaires Marocains dans plus d’une vingtaine de pays Africains, ou encore l’adhésion de Bank Al-Maghrib au système panafricain de paiements PAPSS. Ces outils placeront le Maroc en bonne position pour parrainer des projets pilotes de paiements en monnaies locales, réduire les risques pour les PME africaines et faciliter les échanges intra-Africains.
▪ Quarto, la consolidation des structures productives à travers la promotion de l’industrialisation de l’Afrique. Le but escompté est de décroître la place des matières premières qui se taillent la part du lion dans les exportations Africaines. Faut-il souligner, à ce titre, que plus de 76 % des exportations Africaines émanent des ressources extractives, ce qui n’est pas sans risque sur la volatilité des prix des matières premières et de facto, sur les budgets des pays Africains ?
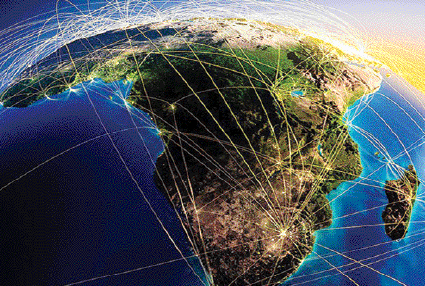
Contrairement aux matières premières et aux secteurs miniers, la promotion de l’industrialisation de l’Afrique permettra de faire progresser les chaînes de valeur industrielles à travers la création de plus de valeurs ajoutées, la création de l’emploi, le renforcement de la croissance et la productivité à même de favoriser une plus grande participation de la région Africaine dans les chaînes de valeur mondiales, de gagner en efficience en renforçant la capacité attractive de l’Afrique. Aussi, la promotion de la politique industrielle de l’Afrique permettra d’asseoir une chaîne de valeur diversifiée et plus compétitive en se positionnant sur les activités à plus haute valeur ajoutée sur l’échiquier mondial.
Si l’Afrique parvient à agencer des chaines de valeur régionales, uniformiser le panorama de sa politique commerciale et consolider son environnement commercial, le potentiel de gains serait important pour le commerce intra-africain. En tous cas, la mise en œuvre de la ZLECAF entrainera d’importantes réductions des barrières tarifaires et non tarifaires entre les pays Africains. Ces réductions pourraient augmenter le flux moyen des échanges de marchandises entre les pays Africains de 15% et le PIB réel moyen par habitant de 1,25%.
Si les réductions des barrières tarifaires et non tarifaires sont combinées à des améliorations substantielles de l’environnement commercial, le bénéfice pour les pays serait significativement plus élevé. Des réformes globales combinées à la mise en œuvre de la ZLECAF pourraient augmenter de 53% le flux commercial moyen de marchandises entre les pays Africains et de 15% avec le reste du monde et, par conséquent, augmenter le PIB réel moyen par habitant de l’Afrique de plus de 10% selon les pronostics du FMI dans son rapport intitulé « Intégration commerciale en Afrique. Libérer le potentiel du continent dans un monde en évolution ».
▪ Quinto, l’investissement dans le capital humain : l’analphabétisme et la carence en formation demeurent les grandes tares de l’Afrique. Les problèmes qui restreignent les capacités des entreprises Africaines sont notamment l’insuffisance des compétences entrepreneuriales et des compétences de gestion, le manque de personnel qualifié, ainsi que les obstacles en matière de recherche et développement. Georges Jacques Danton n’a-t-il pas argumenté qu’après le pain, l’éducation n’est-elle pas le premier besoin d’un peuple ?
Avec une telle carence, la qualité des institutions et des administrations sera déterminante dans la décision d’une entreprise d’investir et d’implanter ses activités économiques dans les pays Africains. Faute d’investissements suffisants dans les compétences, le progrès technologique et l’investissement ne s’accompagnent d’aucun gain de productivité.

▪ Sexto, les gouvernements Africains devront placer la bonne gouvernance au cœur de leurs programmes en vue de la transformation structurelle effective des économies Africaines. C’est une condition sine qua non pour nourrir le développement économique, libérer le plein potentiel de l’Afrique et la conduire sur la voie de la prospérité.
Les pays Africains ont besoin d’un cadre de gouvernance plus propice pour être en mesure de conduire de meilleures politiques publiques et d’obtenir, à terme, de meilleurs résultats en matière de transformation structurelle et de développement inclusif. Sous cet angle, les gouvernements Africains ne sont-ils invités à apporter des réponses aux pertes économiques dues à l’inefficacité des institutions et à l’incompétence.
▪ Septimo, l’Initiative Royale en faveur des États Africains atlantiques, la mise à disposition des infrastructures portuaires Marocaines au profit de 23 pays riverains de l’Atlantique rendra une Afrique maîtresse de son destin, qui transforme ses ressources sur place et renforce ses connexions internes, de la Méditerranée à l’Atlantique et du Sahel aux façades maritimes.
▪ Octavo, le rôle stratégique de la diplomatie économique pour le durcissement de l’intégration régionale et la consolidation de la voix Africaine au regard des grandes puissances étrangères, dans un contexte mondial où les dynamiques économiques mondiales se réorientent de plus en plus vers le continent noir. En pratique, au-delà des sommets Afrique–Chine, la coopération continue de s’organiser principalement sur une base bilatérale, plutôt que régionale ou continentale. Cette orientation conduit souvent à la négligence des autres partenaires Africains et peut, dans certains cas, engendrer des rivalités concurrentielles au sein même des régions du continent.
A cet égard, les États Africains doivent s’appuyer sur une diplomatie économique concertée à même de négocier conjointement leurs intérêts dans le cadre de la ZLECAF et de cristalliser leur pouvoir de négociation sur l’arène internationale et de se doter des moyens qui leur permettre de prendre des décisions stratégiques à partir d’une lecture géopolitique mondiale, en identifiant intelligiblement leurs intérêts économiques et géopolitiques, afin d’équilibrer entre les jeux d’influence et la souveraineté de la décision.
L’intégration africaine, notamment à travers des initiatives comme la ZLECAF, doit s’accompagner d’une diplomatie économique structurée, permettant au continent de parler d’une seule voix dans les grandes négociations multilatérales.

Il est temps d’ériger le futur économique de l’Afrique en barrant les entraves régionales et en verrouillant les réfractions de la répartition des fruits de la croissance, et ce, en posant, les grands jalons d’une Afrique résolument tournée vers l’émergence économique et hisser la ZELCAF à une intégration économique Africaine plus concrète et plus inclusive. Une ZELCAF intervient à un moment où un environnement mondial en mutation crée à la fois des opportunités et des défis pour l’Afrique. Une plus grande intégration commerciale peut aider le continent Africain à tirer parti des opportunités offertes par le changement technologique et les tendances démographiques, et renforcer la résilience de l’Afrique au regard des chocs tels que le changement climatique et la fragmentation géopolitique.